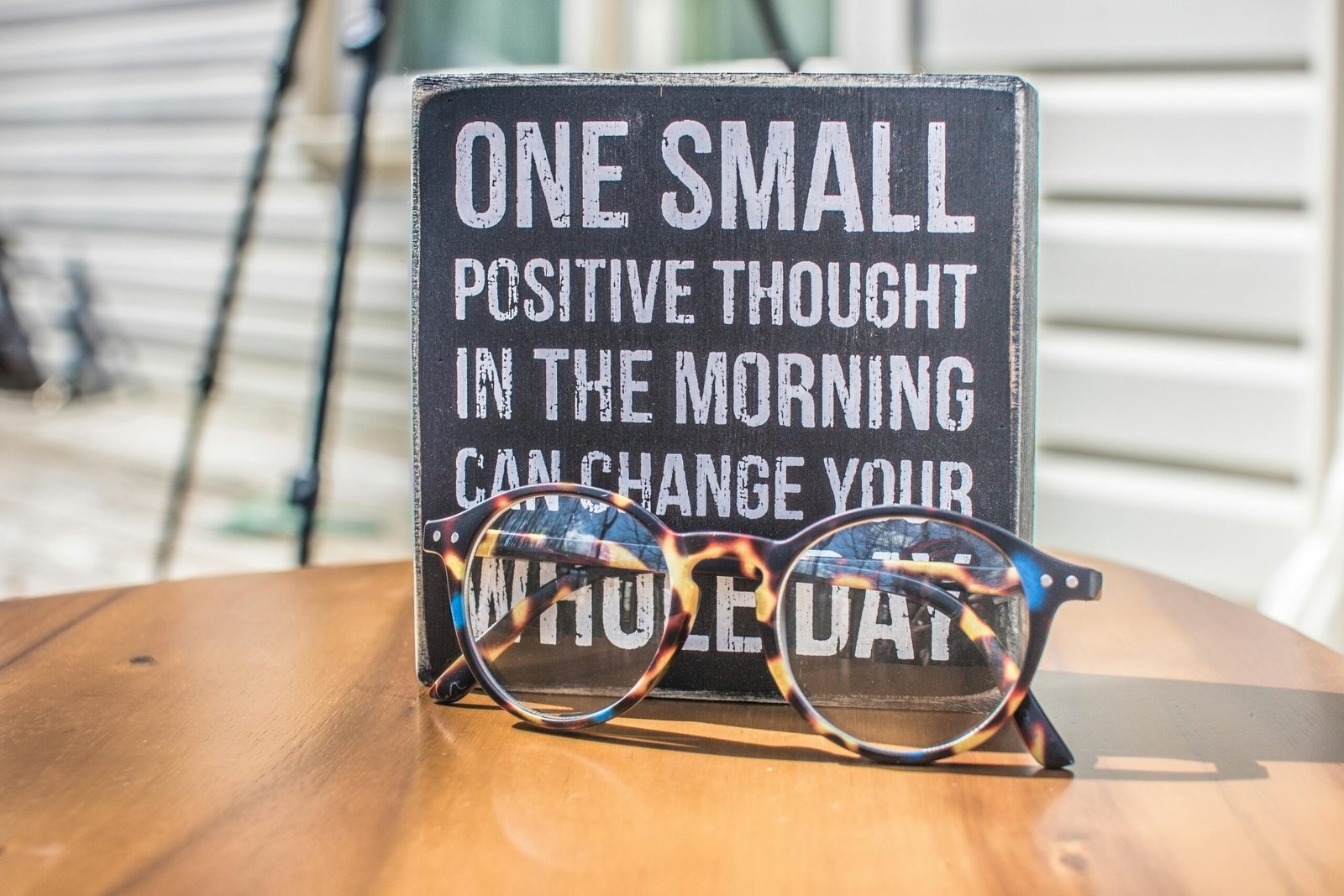
Introduction
Les approches en psychothérapie sont nombreuses et différentes. L’objectif suprême de toutes les démarches est l’aide des patients pour qu’ils retrouvent leurs santés psychiques.
La psychanalyse, fondée par Sigmund Freud et son ami Breuer, a révolu la thérapie psychique. Elle tient toujours sa place comme l’un des projets thérapeutiques les plus distincts.
Freud défend une thèse principale : la pathologie psychique évolue dans le cours de la vie d’un individu. Celui qui n’a pas réussi, à cause des circonstances différentes, à arriver, ou a perdu, à la maturité psychique. Cet échec serait la conséquence des événements traumatiques qui débordent et stimulent l’inconscient. En gros, la technique analytique consiste à inciter le patient à communiquer et associer, en toute liberté, son expérience de vie dans laquelle sa souffrance est nouée. En analysant les éléments suscités, au cours de multiples séances, l’analysant procède, simultanément ou après, à les interpréter et discuter avec le patient les significations décryptées en vue que ce dernier réussit à prendre conscience et contrôle de sa vie psychique et à renouer des relations saines avec son histoire personnelle.
La démarche dans l’analyse est critiquée par les thérapeutes systémiques ou brèves.
Alexander et French mettaient l’accent dans leurs livre ” psychoanalytic therapy”1 sur le facteur temps, car une analyse profonde nécessite un nombre considérable de séances ; et la prolongation des séances d’analyse est justifiée par le souci de dissoudre les résistances qui ferment les clôtures de l’inconscient.
Les systématiciens reprochent, aussi, à la psychanalyse d’avoir culpabilisé la famille, ce qui crée un environnement hostile aux parents, et de faire passe au rôle thérapeutique de l’entourage.
Le projet de la thérapie brève se fondera sur les bases de ces critiques. Elle va se pencher, en premier, sur le raccourcissement de la durée des séances tout en obtenant des résultats efficaces et signifiants : plus qu’on réussi ce projet d’abrègement, plus que le patient sera à l’abri des évolutions imprévisibles de sa souffrance. Puis à structurer son approche sur d’autres prémisses épistémologique.
La thérapie brève et systémique
Cummings définit la thérapie brève: elle vise la diminution la plus rapide, la plus complète et la plus durable possible de la douleur et de de façon la moins envahissante qui soit. (Le qualificatif “durable” fait référence à un apprentissage durable et non à un travail symptomatique)”
La thérapie brève, née au M.R.I de Palo Alto, s’inscrit clairement dans la thérapie de changement. Il s’agit de soulager la souffrance en attaquant ses causes et la dynamique des forces qui les font durer tout en faisant connaissance des modalités auxquelles recours le patient pour entretenir son problème.
Les prémisses théoriques de la thérapie brève
La thérapie brève se dit ciblé et intermittente car le succès du premier travail thérapeutique est synonyme d’une acquisition pour toute une vie. Le patient est appelé à apprendre de nouvelles apprentissages par le biais d’expériences thérapeutiques nouvelles susceptibles de corriger le résultat douloureux des expériences vécu antérieurement. Ceci va avec les prémisses théoriques et pratiques de cette démarche. Il s’agit des prémisses constructivistes, systémique ou cybernétique, concernant la théorie, et les prémisses interactionnelles et étiologique, concernant la pratique.
La prémisse constructiviste
la théorie du psychologue suisse Jean Piaget considère que le développement cognitif est la résultante de l’interaction qui s’établit entre l’individu et le milieu. C’est-à-dire que notre intelligence évolue en s’adaptant au milieu et en organisant, à la fois, ce dernier par nos schèmes intellectuels.
Une idée de base du constructivisme est que nos réalités se construisent et s’apprennent, toujours, en interaction avec le monde extérieur. Ce qui implique qu’une bonne thérapie est celle qui cible ses constructions et apprentissages pour changer la construction et les schèmes responsables de la souffrance.
La prémisse systémique ou cybernétique
Depuis les années 50, l’approche systémique/cybernétique considère que le comportement humain est imprimé par les interactions entre l’individu et le milieu. De ces interactions se mobilisent des déterminismes psycho-cognitives qui se modélisent en un système. Ce dernier est régi par le principe de l’équifinalité qui indique qu’un même système peut générer des résultats identiques en partant des états initiaux différents et devient, au cours du temps, indépendant de ces états initiaux. Il est, donc, nécessaire pour la thérapie d’interroger et de travailler sur les informations du système illustrant la relation circulaire entre les états initiaux et leurs effets.
Les prémisses pratiques
De ces prémisses théoriques, se précisent deux prémisses pratiques : la prémisse interactionnelle et étiologique.
La vision interactionnelle oriente l’utilisation du mode de fonctionnement du système, ses interactions constructivistes, pour designer et renforcer les modèles d’interaction correctifs. Ce sont les modèles susceptibles de corriger les facteurs pathogènes, qui génèrent un ou des problèmes psychiques (comportements ou émotions non-désirés).
L’étiologie d’un problème psychique dépend de trois ordres de conditions:
– La mauvaise gestion de certaines situations dans la vie ;
– L’échec des tentatives de solution; et plus on persiste à adopter ces tentatives, plus on continue à rationaliser, par dissonance cognitive, les attitudes mauvaises et problématiques.
– Et le conservatisme cognitif qui explique la tendance du patient à conserver des schémas explicatifs personnels et à valider les éléments qui les corroborent tout en négligeant ceux qui les infirment.
l’intervention thérapeutique a deux objectifs: celui d’amener, en premier lieu, les acteurs dans le contexte à remettre en doute et abandonner les solutions tentées auparavant et à recadrer, en deuxième lieu, le système en vue de promouvoir des comportements radicalement différents.
Le thérapeute se renseigne, d’abord, sur le problème, identifie, en utilisant les ressources du système, un membre plus motivé à changer, ensuite, et prévoit le changement stratégique qui va déterminer les mesures et de son intervention.
Le problème de la dépression entre thérapie brève et analyse
L’expérience dépressive est hétérogène. On en distingue quatre manifestations : la manifestation émotionnelle, cognitive, physiologique et interpersonnelle. De l’humeur triste, anxiété, hostilité, dénie de la souffrance, l’impuissance, les distorsions cognitives, les troubles de sommeil ; d’appétit ; de sexualité, douleur somatique jusqu’aux troubles relationnels et comportementaux.
l’école Palo Alto 3 pour une approche interactionnelle et systémique des situations dépressives
Le problème psychique est synonyme, dans la conception de l’école Palo Alto, d’un comportement non-désiré ou déviant. Il indique une rupture avec un désir, norme ou valeur qui génère des mécanismes de régulation. Ces mécanismes/comportements sont convoqués soit par le sujet, soit par sa famille à titre de correcteurs qui trouvent sens subjectivement au sein du contexte familial. La culpabilisation parentale, la morale, les exigences sociales et culturales peuvent entraîner l’individu dans des situations dépressives, entre autres, au cas où il échoue à mobiliser des réponses adéquates.
Contrarié, un problème est un comportement qui va de soi. Et l’individu, et l’entourage vont tenter de retrouver la situation d’avant problème. C’est une tentative vaine, car l’énergie sollicitée manque au déprimé. Cette stratégie n’aide point et aggrave, par contre, la situation.
Mariana et al. 4 ont dessiné le cycle d’apparition et du maintien des situations dépressives qu’ils ont nommé le cycle de” désillusion-renoncement”.
La désillusion est l’expression de la chute des croyances auto-confirmées au fil du temps et qui constituent le voussoir de la relation avec soi, les autres et le monde. Elle se prononce lors des périodes de transition, des événements difficiles, des expériences traumatiques ou de doute.
Deux types d’illusions sont à différencier : les illusions positives sur un monde paisible et sans problèmes ; et les illusions négatives d’un monde sans solutions.
Le renoncement traduit la tentative du sujet à revoir ces illusions pour éviter le conflit, en premier lieu, renoncer partiellement, en deuxième, et le renoncement global, signe de résignation, à la fin.
La thérapie brève de la dépression, dans la perspective de l’école Palo Alto, suit le protocole suivant :
Le protocole commence par une démarche paradoxale. Elle a pour objectif de tenir une position basse par rapport à la situation permettant au thérapeute de s’adapter au langage que parle le déprimé et son entourage, d’un lieu, et d’installer une stratégie de coopération avec le patient, d’un autre. Il faut, alors, laisser le patient parler sans intriquer ni ses motivations, ni ses illusions, d’un deuxième lieu. Pour cela, le thérapeute doit positiver le problème, respecter le droit d’être déprimé au patient et avancer en lenteur tout en faisant comprendre au déprimé les risques probables de son problème ;
Ensuite, le thérapeute interroge le système afin qu’il repère le mode relationnel optimal au patient, la dynamique du système ainsi que ses acteurs ; et en vue de désigner “le membre plaignant”, celui qui se plaint, fait les efforts infructueux pour surmonter le problème et fait appel à l’aide professionnel.
Le choix du membre plaignant est légitime, car en supposant que le comportement de l’individu se constitue dans l’interaction, la modification du membre plaignant changera l’interaction. Ce qui implique le changement nécessaire du comportement. Le plaignant peut être soit le déprimé, l’entourage ou un tiers. (police,
| Le travail avec le patient | Temps 1 | Temps 2 | ||
| Approche paradoxale | Tache _____________ Objectif | Déclencher un phénomène spontané ou non-dépressif _________ Révéler mécanismes responsables et de soulagement | Déclencher un phénomène spontané ou non-dépressif _________ Révéler mécanismes responsables et de soulagement | |
| Approche auto suggestive | Proposer un scénario positif et réalisable | Négocier un objectif minimale | ||
| Le travail avec le conjoint ou l’entourage | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | |
| Validation Valider et accepter l’attitude de l’entourage | Cohérer L’entourage/conjoint et thérapeute s’entraident et se communiquent librement | Recadrage Positiver la position dépressive + prescription comportementale | ||
| Prescription comportementale (entourage ou conjoint) | ||||
| Se désengage progressivement de la relation de soutien | ||||
| Utilisation des période d’exception | ||||
| Deviner les initiatives du patient pour cacher son vécu dépressif (éviter les critiques) après la stimulation de sa détresse | ||||
| Écoute et observer ce qui se réalise sans intervenir (conjurer le silence) | ||||
thérapeute, médecin…)
Le travail thérapeutique va consister à :
Stimuler le discours du patient et de l’entourage pour que le thérapeute se positionne ;
Identifier les éléments suspects, dans le système, d’être responsables de la souffrance, ainsi que les tentatives vaines sont identifiés ;
Atteindre un objectif minimaliste et réaliste de la thérapie définit.
Expérimenter d’autres façons de considérer différemment la situation ;
Prescrire des comportements curatifs au lieu de médicaments.
De la prescription comportementale à la consolidation du changement
La consolidation se concentrera sur le suivi des micro-changements et la sécurisation.
La psychanalyse
La psychanalyse considère que la psyché évolue dans le conflit. Le deuxième topique met l’accent sur le conflit entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Cette dernière traduit la tendance de la psyché à retrouver l’état de tension nulle. La haine, la destructivité et les tendances négatives en sont des expressions. La pulsion de mort intègre toute sorte de comportements de désunion et sur le plan psychique et le plan social. Avec la pulsion de vie, au contraire, la psyché tend vers l’amour, la construction, la coopération et tous les comportements ou le désir d’union est y sous-tendu.
Le mécanisme essentiel, considérait Freud, avec lequel la psyché peut surmonter la pulsion de mort. Cependant, des problèmes comme la dépression et le sadomasochisme démontre que cette pulsion peut être introjectée dans la psyché et introduire le conflit pulsionnel à l’intérieur, ou bien les deux pulsions entrent en fusion. La tendance vers l’union et l’amour, et la tendance vers la souffrance et la douleur s’intercalent et produisent des troubles psychiques.
Si Freud avait lié l’angoisse aux refoulements automatiques des pulsions libidinales, Mélanie Klein, quant à elle, l’avait attaché aux pulsions destructrices provenant de la pulsion de mort. “La frustration libidinale augmente et libère l’angoisse en accentuant l’agressivité alors que la gratification libidinale diminue l’angoisse ou le maintien peu conscient”. 5 leçons
L’association libre est la technique classique pour entrer à l’inconscient et délier l’énergie mal investie par les pulsions et qui produit une dynamique psychique négative. Couché sur un divan, le patient est appelé à parler librement. Pensées, émotions, résistances, illusions et représentations se prononcent directement ou indirectement. En premier temps, ce langage, constitué de mots, de gestes et d’expressions diverses, se transfert. L’analysant reçoit ce langage et ses modes transférentiels, attentivement et librement, pour qu’il arrive, par la suite, à décrypter, par interprétation analytique, les significations véhiculées et transmises. C’est ainsi que la psychodynamique inconsciente se dévoile et que les résistances se dissolvent. Et en se dévoilant que le patient se libère et peut renouer une nouvelle relation, de plus au moins consciente, contrôlée en soi et avec les autres.
Le traitement psychanalytique de la dépression repose, donc, sur l’analyse et l’interprétation du langage, qui comprend le langage du corps et du rêve, du déprimé. Cette analyse mènerait l’analysant à voir les mécanismes et les événements traumatiques qui ont conduit vers la dépression.
L’analysant doit lire l’écart qui s’installe entre le signifiant et le signifié, le donné et le déduit, le divulgué et le dissimulé, le manifeste et le latent, le représenté et le non-représenté. Ce travail intellectuel est nécessaire pour la restitution de l’histoire du patient pour qu’il réussisse à:
- prendre conscience des arrière-gardes des sentiments de haine qui le détruisent et peuvent le pencher vers le seuil du suicide.
- Remettre en scène perceptible les refoulés, leurs dynamique et leurs effets négatifs;
- Profiter du dynamisme pulsionnel pour que la pulsion de mort éveille la pulsion de vie et renaître son élan vital.
- Prendre conscience du travail de ses phantasmes….
Conclusions
Pour nous, l’opposition ou la complémentarité entre thérapie brève et l’analyse (et les autres approches en psychothérapie) ne sont qu’un sujet qui allument les débats philosophiques entre les protagonistes et les antagonistes de cette démarche ou l’autre. C’est un débat qui peut être pensé au niveau de l’épistémologie non au niveau de la pratique. Certes que la théorie et la pratique s’entremêlent pour développer des paradigmes thérapeutiques plus efficaces, mais ce qui compte pour un thérapeute est d’opérer avec toutes les outils nécessaires pour apaiser la souffrance de son client privé et la clientèle mondiale en général.
Les ponts entre thérapie brève, marquée par la systématisation, et la psychanalyse se bâtissent de jour en jour. C’est ainsi que Jackson (1962) et Haley (1963) ont réalisé des effets thérapeutiques de la psychanalyse à partir d’une vision interactionnelle. En effet, l’interaction paradoxale entre analysant et l’analysé est bénéfique pour que l’analysé arrive à se comprendre mieux, à changer son comportement ainsi que sa relation avec l’entourage.
L’interaction est le pont idéal ou se rencontre toutes les approches en psychothérapie. Elle fait naître l’intersubjectivité qui permet la création d’un nouveau monde pour les phantasmes, les croyances, les rêves et les comportements, et c’est dans ce monde étrange que se réalise des miracles thérapeutiques qu’on ne peut pas toujours expliquer. Les fantasmes et les rêves, ne sont-ils pas des scènes interactionnelles de “double-lien, double-nouage, mythes et rituels, contre-transfert et résonance, objets flottants et objets transitionnels?”
La restauration de l’individu dans sa singularité est possible, pour une cybernétique de second ordre, si on réintroduit cette dimension intersubjective et subjective des états psychiques. Cette cybernétique se marie donc avec la psychanalyse pour construire et reconstruire de nouveau l’être-patient et un nouvel entourage et de nouvelles interactions.

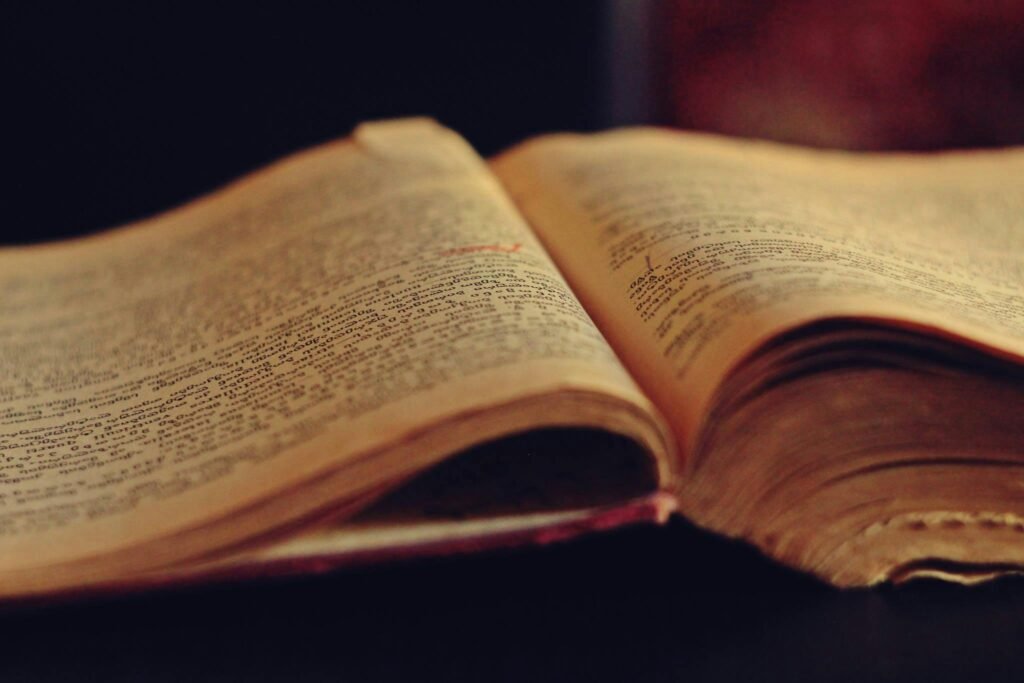
No responses yet