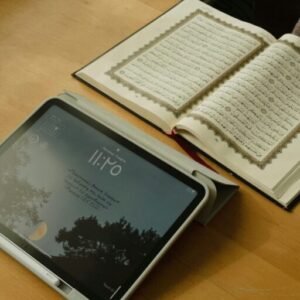 Introduction
Introduction
Dans le mot “religion” s’articule deux signifiants: le préfixe(re)et le verbe “lier”. Si on accepte que le mot religion, qui vient du latin religio, signifie “scrupule, conscience” mais aussi “crainte pieuse, sentiment religieux” et de ” la vénération, culte, pratique religieuse. De cette articulation, on peut supposer deux hypothèses. La première est que la scrupule, la conscience, la crainte, la vénération, la culte et la pratique dans la religion sont destinés à retrouver le lien avec le divin. La deuxième, si on part du verbe latin relegere (ou religere en latin tardif), qui signifie “relire, réélire”, s’explique par Cicéron, qui oppose le religieux ( qui fait une fois le culte, puit relit consciencieusement le compte-rendu de cérémonie pour vérifier que tout a été fait correctement) au superstitieux (celui qui répète plusieurs fois les cultes tant il a peur de la mort). Relire et réélire demande, par cette explication, de faire preuve d’intelligence, de diligence et d’élégance. Saint Augustin suppose que l’action de la relecture et la réélection consciente ne peut que mener la personne à choisir et élire Dieu, et revenir, sans cesse, à lui.
Le débat moderne conclut que relegere est plus proche des cultes romains, alors que religare est inventé par le christianisme.
L’acceptation de l’une de ces deux définitions serait donc, un choix justifié par des conditions historiques, politiques et culturelles.
À partir de cette hypothèse, on peut inscrire la conception de freud, héritier des lumières, de la religion. Le point de vue de la psychanalyse sur la religion est celui de l’anthropgenèse: elle entend comprendre la religion à la fois comme un destin collectif dans l’histoire de la culture est comme une fonction psychique dans le rapport de l’individu au monde.
La religion, dans cette perspective, est un phénomène qui a pris sa place dans le cours du processus qui va mener les êtres vivants à dépasser l’état de nature, état postulé par les philosophes politiques du contrat social pour théoriser l’évolution des institutions sociales, culturelles et politiques.
La culture, dans sa définition anthropologique, est l’ensemble de valeurs, normes, règles…, voués, dans chaque groupe sociale, à délimiter le cadre de de l’être individuel par rapport au cadre de l’être collectif. L’intégration sociale de l’individu se définit par le respect mutuel de son cadre existentiel individuel et le cadre existentiel de la société.
La religion, en tant que phénomène culturel, est parmi les éléments de la culture mis au service de ce devoir d’intégration que l’individu doit assumer. Ce dernier est obligé, par ce fait, de se dénaturer de ses désirs et pulsions anti-culturels. Le prix de cette renonciation est que la religion va dédommager l’individu par la transmission d’un savoir qui lui promet une vie réelle de vertu et de morale, d’un coté, la jouissance éternelle dans de l’au-delà, de l’autre. Dans le christianisme, par exemple, il est dicté que la vie paradisiaque est l’indemnisation correcte des vexations dont l’homme est victime dans cette terre. La croyance religieuse est, aussi, le garant pour une vie sous la protection d’une puissance supérieure, ayant la figure d’un père, des vicissitudes de la nature et du destin.
Freud qualifie le savoir religieux d’illusoire puisqu’il ne peut pas être vérifier par la méthode scientifique positiviste. Toutefois, Lacan dégage une valeur psychanalytique et ontologique considérable de ce savoir. Dans sa conférence de presse, tenue à Rome en 1974, Lacan pense que la valeur-ajouté de la religion est d’ordre symbolique:” tout ce qui est religion consiste à donner un sens aux choses”1. La symbolisation religieuse lie l’homme au monde de dieux pour qu’il compense sa faiblesse et son besoin de sécurité et son désir de de puissance en les projetant sur des dieux, qu’il a crée à son image.
Qu’il est l’origine de la religion? Sur quel mécanisme psychique repose son savoir?
L’origine de la religion en psychanalyse:
analogie symptôme névrotique et symptôme religieux.
Freud a consacré plusieurs écrits à l’étude psychanalytique du phénomène religieux tels “Totem et tabou” et “Moise et la religion monothéiste”.
En supposant que la psychologie des masses est analogue à la psychologie individuelle, Freud mettait en lumière en quoi le symptôme névrotique correspond au “symptôme” religieux.
Le symptôme signe une vérité, la vérité, en ce qui concerne le symptomatique névrotique, de certains traumatismes, de certains expériences, impressions et blessures narcissiques. Ces expériences sont précoces, immomérables et de contenu sexuel.
En effet, toutes les expériences traumatiques apparaissent à la première enfance (jusqu’à cinq ans), sont, généralement, oubliées, se rattachent à des impressions de nature sexuelle et agressive, et se reportent à des atteintes au Moi (blessures narcissiques).
Les effets des traumatismes sont positifs ou négatifs. Ils sont positifs parce qu’ils se fixent et se répètent; ce qui permet au sujet de les remémorer et les re-expérimenter dans ses relations réelles. Ils sont négatifs lorsqu’ils sont attaqués par des mécanismes de défense névrotiques d’évitement, qui peuvent s’aggraver et devenir des phobies et des inhibitions.
Une névrose est la conséquence d’un traumatisme précoce qui fini par le retour partiel du refoulé, tout en passant, successivement, par la réaction défensive, une période de latence et l’éruption de la maladie névrotique.
Cette généalogie est identique, pour Freud, la généalogie des phénomènes religieux. Ces derniers ne sont que des symptômes des expériences traumatiques, actifs et oubliés, vécus au cours de l’histoire évolutive de l’espèce humain.
L’histoire du traumatisme de l’espèce humain débute lorsque les fils décidèrent de tuer le père pour mettre fin à sa domination et son appropriation privée et injuste des femmes de la horde.
Pourtant, ce parricide originaire conduisait les fils au conflit sur l’héritage paternel, et faisait lieu à une ambivalence émotionnelle: culpabilité et jouissance, amour et haine, envers le père tué. Cette situation chaotique et conflictuelle ne serait résolu qu’avec la conclusion d’un pacte social entre les frères. Ce pacte exigeait qu’ils renoncent aux pulsions et reconnaitre des obligations mutuelles.
Trois ordres d’interêts allaient voir le jour dans l’histoire humaine:
- un ordre éthico-politique, avec l’institution de la morale, du droit, du devoir et du sacré;
- et un ordre psychologique. Le souvenir de l’acte de libération meurtrière, fantasmatique ou réelle, était l’origine de la dualité ambivalente de la relation affective au père, le conflit entre le désir de jouir (haïr le père) et le sentiment de culpabilité (l’amour du père).
- un ordre anthropologique avec l’instauration de l’inceste, le tabou et l’exogamie, et l’avenue de l’aire matriarcale.
La prohibition taboue tire sa force de la “terreur sacrée” projetée dans les comportements d’évitement face à l’objet tabou. Évitement qui s’exprime dans la crainte de contact et de toucher. Ses tabous “primitifs” se conforment avec les phobies de toucher rencontrées dans certains névroses obsessionnelles. Le jeu de refoulement décrypté dans le symptôme phobique est la conséquence d’une prohibition extérieure de la tendance du toucher chez le petit enfant. Elle est tolérée par le petit car elle provient de la mère.
Le système totémique est équivalent du complexe d’oedipe. La tentation de tuer le totem, le père donc, est interdite sous la menace de castration “sociale”. Freud fini par dire que la première forme culturelle de l’humanité est conditionnée par le complexe d’oedipe. Ce dernier serait considérée comme le noyau autour duquel gravitent les formations religieuses et névrotiques.
La religion considérée comme la névrose obsessionnelle de l’humanité.
Au troisième chapitre de ” l’avenir d’une illusion” Freud déclare que la religion “est la névrose obsessionnelle de l’humanité”. Il montre aussi, dans le texte “actions compulsionnelles et exercices religieux” que le cérémonial obsessionnel, ou actions compulsionnelles, ressemble fortement au rituel religieux.
Le cérémonial obsessionnel est l’ensemble d’actions dénudées, manifestement, de sens et qui se caractérisent par leur compulsivité. Tout écart à ce rituel provoque de l’angoisse. En faite, le malade craint, sans qu’il peut justifié sa crainte, d’être puni s’il n’accomplit pas ou accomplit faussement que ce cérémonial. Il s’agit d’une sacralisation identique de celle du rituel religieux. Cette ressemblance se montre aussi dans la débandade entre les actions prohibées et les actions autorisées dans le cérémonial obsessionnel et religieux.
Le sens dissimulé des actions compulsionnelles, dans l’obsession comme dans la religion, se forme dans l’histoire inconsciente du sujet. Ses actions trouvent leurs sens dans les évènements de sa vie ou dans ses désirs refoulés. L’angoisse du névrosé obsessionnel est liée à l’attente d’une punition que suscite la perception inconsciente d’une tendance sexuelle fou agressive. L’accomplissent du rituel obsessionnel n’est, en fin de compte, qu’une attitude défensive du Moi, rendue nécessaire par le sentiment inconscient de culpabilité.
Le Surmoi, le porte-parole psychique de la loi sociale intériorisée au cours du processus de la socialisation, couve le sentiment de culpabilité dans le cas de la névrose obsessionnelle. La religion serait donc le pendant culturel du Surmoi dans la psychologie des masses. Elle rappelle à chacun la volonté du père primitif pour le contraindre à renoncer à ses pulsions.
Si la religion était nécessaire pendant l’enfance de l’humanité, elle est destinée à l’abandon et au déclin une fois que la science, dans les temps contemporains, arrive à en surpasser.
Religion et mécanisme de défense
Trois étapes dans l’interprétation freudienne de la religion:
1- la religion comme projection: la religion est une projection sur le monde extérieur d’une réalité psychique de nature paranoïaque et superstitieuse. Le parallélisme étroit entre les actes compulsifs des névrosés et les actes de piété que s’impose le croyant: il s’agit de mesure de protection contre les dangers pulsionnels.
2- la religion comme refoulement du meurtre du père: dans Totem et Tabou, Freud montre que le complexe d’oedipe est le point d’articulation fondamentale de l’hominisation. Le haine à l’égard du père était vouée à l’échec à cause de la rivalité des frères entre eux. En conséquence, l’identification complète au père n’aurait pas lieu. La prise en conscience de cet échec laisserait la place au motions tendres et culpabilité (induisant le double interdit de la mise à mort du totem et de l’usage sexuel des femmes, ce qui rend nécessaire l’exogamie). La fonction de la religion serait de construire des défenses contre toutes les représentations sous tendues par la haine du père et entre frère, soit par le déni soit par le refoulement. (Le déni propre au monothéisme égyptien, le refoulement au monothéisme chrétien, distingue Roquefort).
La religion est une défense contre l’angoisse
Lacan pense que la croyance est inhérente à la structure du sujet. Pour lui, l’inconscient est structuré comme une langage. Tout ce qui nous contrôle et nous traverse se code en une série de signifiants construits au lieu de l’Autre. Ce “trésor de signifiants” et “lieu de la vérité”, pensait Lacan.
Dieu, considère ce dernier, est une des figures de l’Autre, il est un des lieu de vérité. En conséquence, la croyance, qui concerne la personne, doit être distinguée des systèmes religieux.
Le sujet a recours à la croyance pour la seule objectif, celui de se défendre contre l’angoisse. Lacan pense que la structure de l’angoisse ressemble à celle du fantasme. Ce dernier, estime-t-il, est une composition grammaticale utilisée par la pulsion, en suivant divers renversements, pour trouver jouissance et organiser notre relation avec le monde. Dans sa relation avec le monde, le “je” doit passer, obligatoirement, par le fantasme, malgré que le ‘”je” y est exclu. “L’enfant est battu” montre bien cette exclusion.
“L’angoisse surgit quand un mécanisme fait apparaitre quelque chose à la place de (-ph)”, de la castration. elle est la seul affect qui ne trompe pas et s’éprouve une fois le réel est dévoilé. L’angoisse est le sentiment de liberté par excellence en tant qu’elle divulgue la condition solitaire, la plus fondamentale de l’être humain, cet être sans appel et sans protection. C’est grâce à l’angoisse que l’homme peut dire “non”, revendiquer du sens, faire de l’art, participer à la culture, penser, croire et parle.
La religion, avec sa capacité énorme à secréter le sens , est indispensable à l’homme pour la temporisation, contenir, circonscrire l’angoisse produite par l’envahissement du réel. La conception contemporaine du savoir scientifique est suspectée dans la mesure où c’est elle qui nous livre à cette angoisse.
Conclusion
l’émergence de l’interprétation psychanalytique de la religion est liée à la synthèse de trois notions: la horde patriarcale primitive décrite par Darwin, les conflits entre les mâles en vue de la jouissance des femmes décrit par Arkinson et le repas sacrificiel totémique décrit par Taylor.
La religion est le lien sacré avec le “divin”. Freud insiste sur l’origine terrestre de ce dernier. Il s’intègre dans le processus historique qui va mener l’homme à ajuster sa nature avec la culture. La religion utilise le principe freudien de “plaisir” pour solidifier son statut dans la vie des gens. Il est utilisé comme un pari, au sens de Pascal: en pariant sur la religion, en renonçant aux pulsions et obéissant aux devoir religieux, l’homme sera récompensé, dédommager, par une vie, si-bas, sous le nom de la vertu et de la morale, et d’une vie si-haut, sous le nom de la jouissance éternelle, ou ce plus-jouissance, au terme de Lacan.
L’idée princeps de Freud consistant à dire que la religion serait née du meurtre du père par ses fils et de la culpabilité ultérieure l’a conduit à décrire cette émergence en trois étapes:
- le meurtre du père par les fils;
- La consommation de son corps en vue de s’approprier sa substance vitale et de s’identifier à lui;
- Le retour des motions tendres à l’égard du père sous forme de culpabilité qui s’impose dans le cadre des sociétés totémiques, une double interdiction- celle de tuer le totem dressé à l’image du père mort et celle de jouir des femmes du clan— que l’on trouve précisément dans le complexe d’oedipe.
Ce jeux de la religion, pour Freud, est utile pour l’homme-enfant, l’homme du stade théologique dans la théorie positiviste d’Auguste comte. Il sera sans intérêt pour l’homme-adulte, celui du stade positiviste dans lequel la science et, surtout la psychanalyse, va poser à la main de cet homme les moyens de contrôle et de commande sur son destin.
La religion est, dit Freud, une illusion qui a pris le statut d’un savoir vrai dans la conscience des gens parce qu’ils ignorent sa généalogie. La généalogie a pour objectif, chez Nietzsche, de trouver les origines des valeurs qui ont fondé toute l’histoire de l’homme.
En relation avec cet objectif, freud a mis en lumière la correspondance entre le symptôme névrotique et le “symptôme” religieux. cette correspondance repose sur l’hypothèse de l’existence d’une symétrie entre la psychologie des masses et la psychologie individuelle.
Le symptôme névrotique comme le symptôme religieux, est le signe d’une vérité qui se reporte à des blessures narcissiques, des traumatismes précoces, dont le contenu est sexuel, qui ont été oublié. La différence entre les deux ordres de symptôme concerne, seulement, la psychologie à laquelle il font référence: le symptômes névrotique s’explique au niveau de la psychologie individuelle alors que le symptôme religieux fait référence à la psychologie des masses.
L’homme manifeste dans la religion un vérité sous forme déplacée. Au début freud assimile la religion aux mythes et aux légendes, qu’il explique par “la projection”. Il s’agit des représentations de désirs pulsionnels, vaguement perçue de manière end-psychiques, transposées dans l’extérieur et mettant ainsi en scène une réalisation de désirs interdits à l’homme tels que l’inceste, ou contredits par la réalité comme l’immortalité (Naissance da la psychanalyse. Lettres à Fliess, 71 et 78).
Critique
Reste à remettre en question l’interprétation psychanalytique classique, de freud, du statut de la religion dans l’histoire des peuples. Freud reste auto-centrique puisqu’il généralise son interprétation en partant des formes religieux et mythiques occidentales: la mythologie grecque et la religion monothéiste judéo-chrétienne. Qu’on est-il de l’islam et les religions de l’extreme orient: le bouddhisme, le brahmanisme…? Est ce que la notion du père-dieu y occupe le même statut? ….
Roquefort reproche à Freud de ne pas penser les rapports réciproques entre les monothéismes. Freud n’a jamais mentionné le monothéisme musulman; “il y a certainement, et de déni et du refoulement”. Déni réciproque de l’existence des autres monothéismes, comme si le poids de la faute exigeait de chacun d’entre eux de la porter intégralement pour espérer le salut en occupant imaginaient tout l’espace du sacré. Refoulement de l’héritage du meurtre reçu pourtant toujours d’ailleurs et toujours appelé de ce fait à faire retour sous de nouvelles guises.