Introduction
Selon le vocabulaire de la psychanalyse, un traumatisme psychique “est un événement de la vie d’un sujet qui se définit par son intensité, par l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre adéquatement, par le bouleversement et les effets pathogènes et durables qu’il provoque dans l’organisation psychique”. Le traumatisme, explique Didier Anzieu, se rattache à deux conditions:
– l’intensité de l’excitation: si l’excitation dépasse le niveau acceptable pour le fonctionnement psychique normal, consistant à protéger le sujet de la fracture de son système de la pare-excitation, l’excès d’énergie, lié à l’excitation, s’infiltrera, traversera et pénètrera dans l’appareil psychique.
– et le degré de la tolérance du Moi: au cas où la résilience du Moi, son énergie et sa capacité de liaison auraient affaibli la force pathogène du facteur traumatique sera forte et le traumatisme prendra place.
La névrose traumatique (Freud) est la conséquence d’un manque de préparation du Moi à l’angoisse et du fléchissement de la résistance des systèmes que l’excitation attaque en premier. Le traumatisme est révélateur de l’incapacité du Moi à assumer ses responsabilités psychiques. La faiblesse du travail psychique donne lieu à l’angoisse que provoque le déni de l’image traumatique creusée dans l’inconscient. Ce n’est que plus tard que le sujet se rende compte des effets de cette image. Didier Anzieu pense que l’évènement traumatique est une rencontre avec l’image de la mort qui envahit le psychisme brutalement et à l’état brut puisqu’elle s’agit d’une image sans mots et sans représentations. Elle s’agit d’une image intensive qui dérègle le fonctionnement de l’appareil psychique. Et c’est ainsi que des troubles psychiques comme le syndrome de répétition, l’angoisse et la dépression apparaissent.
La fonction synthétique du Moi Le Moi, selon Freud, accomplit trois missions principales:
1. le maintien de ses fonctions de réconciliateur entre ses trois maitres: le Ça, Surmoi et la réalité matérielle;
2. Limiter la pénétration des forces destructrices;
3. L’organisation des relations entre les pulsions venantes du Ça et les ordres dictés par le Surmoi, tout en cherchant une meilleure collaboration entre les deux.
Ce qui caractérise le Moi est “sa propension à la synthèse de ses contenus, au regroupement et à l’unification de ses processus. “La tâche du Moi consiste à “instaurer l’harmonie parmi les forces et influences qui agissent sur lui et en lui”. Lorsque le Moi est obligé à avouer sa faiblesse, il éclate en angoisse. Cette fonction synthétique, que Freud avait pensée comme allant de soi, est soumise à des perturbations et à ses conditions. Pensant que le “Moi est clivable” (1932), Freud prétend, d’abord, que le clivage du Moi est réversible: “le Moi se clive au cours d’un bon nombre de ses fonctions, au moins provisoirement. Les fragments peuvent se réunir par la suite”. Le clivage du Moi, selon cette première conception, est utile pour deux causes: il est une défense contre l’angoisse et il est le responsable de la différenciation psychique du Surmoi et de l’idéal du Moi. Ces deux instances, qui vont permettre la mise en oeuvre du refoulement, se constituent grâce à l’identification d’une partie du Moi au Surmoi des parents à l’issue du complexe d’oedipe.
En 1938, et dans l’article sur le clivage, Freud revise la thèse de la réversibilité du clivage du Moi. En réalité, les ratés de la fonction synthétique du Moi peuvent être l’origine des clivages sévères, repérables dans les structures non-névrotiques: la psychose et le fétichisme. Le clivage du Moi Page 3 Le clivage du Moi se lie, directement, à la déchirure que le Moi subit comme conséquence à sa réponse au conflit entre la revendication pulsionnelle (l’onanisme) et le danger de la réalité (la castration). Le clivage exprime une “intelligence” qui tient en compte le désir et la réalité. Le Moi adopte deux réponses opposées: “il choisit, dans le même temps, de dérouter la réalité et de la respecter, tout en acceptant, sous forme de symptôme, l’angoisse engendrée par ce choix”. Angoisse qu’il va chercher à s’en garantir ultérieurement. Il s’agit d’un clivage permanent, inguérissable et grandissant. La fonction synthétique du Moi ne va pas de soi, donc; elle a ses conditions et se trouve soumise à toute une série de perturbations.
Freud analyse l’exemple d’un petit enfant à l’âge de 3 ou 4 ans. La satisfaction pulsionnelle lui est menacée par la castration (attribuée au père). Une menace qui devrait engendrer un effroi angoissant. Pourtant, le petit enfant continue sa quête pour le plaisir et ne reconnait plus la réalité de la castration. Pour lui: “Ce qui manque à la fille poussera plus tard”. Ainsi il recourt à la substitution fétichiste qui lui permet de renier la réalité et sauver son pénis. Renier la réalité et suivre la satisfaction est un processus que Freud attribue à la psychose. Il ne s’agit pas, pourtant, du même processus. Il s’agit seulement, dans ce cas, d’un déplacement de valeur qui consiste dans le transfert de la signification du pénis à une autre partie du corps féminin. Malgré tout, la poursuite de la satisfaction se côtoie, chez le petit enfant, par une angoisse, dû au châtiment du père. Une angoisse exprimée par le développement d’un symptôme qui témoigne que l’enfant reconnaît le danger. Avec le développement de sa masculinité, l’enfant va réussir à se familiariser avec cette angoisse.
Le clivage d’objet
Le clivage d’objet Le moi primitif est bien constitué et il est capable de nouer des relations objectales, subjectives et cognitives au sein de sa condition humaine dans la conception de Melanie KLEIN. Elle avance la thèse que le conflit mettant en jeu les pulsions de vie avec les pulsions de mort est un conflit inné et précoce. Ce conflit est l’origine de l’angoisse du moi primitif, angoisse liée au sentiment de persécution et aux menaces d’anéantissement par les pulsions de mort. Cependant, le moi adopte des stratégies défensives, comme le clivage d’objet et du moi, pour préserver l’enfant dans son intégrité identitaire et existentielle. Klein affirme que le clivage est nécessaire, au départ, pour la structuration de l’appareil psychique de l’enfant. Il s’agit d’un clivage fonctionnel qui consiste, d’abord, en la scission de l’objet perçu (le sein de la mère) en deux: un objet bon et aimé, et un objet mauvais et haï. La préservation du premier et l’éjection du deuxième protègent l’enfant de la haine et du sadisme. Le monde interne des petits enfants est caractérisé par la violence. Il est animé par des fantasmes sadiques oraux, anaux et urétraux. La scène fantasmatique est activée par des objets partiels qui se conforment, dans leurs rôles, à des émotions opposées: l’amour et la haine. Le bon sein nourricier et gratifiant est lié à l’amour, tandis que le mauvais sein qui, par son absence, prive l’enfant de la satisfaction et de l’apaisement attendu, devient persécuteur et haineux. Le clivage d’objet est décisif au niveau des relations objectales. Les bons objets internes sont formés grâce à l’incorporation du bon sein, alors que les mauvais objets internes sont liés à l’introjection du mauvais sein. À ce moment, l’objet, bon ou mauvais, et perçu et incorporé en tant que deux objets différents. Ce n’est que progressivement, et à cause de mécanismes de synthèse rendue possible par le développement cognitif, que l’enfant va pouvoir intégrer les différents composants de l’objet en un ensemble. Toutefois, l’investissement émotionnel de l’objet, devenu complet, reste inchangé. À ce stade l’angoisse est justifiée par la crainte de l’enfant d’être poussé par la haine à la destruction de l’objet gratifiant qu’il aime. Le clivage s’active, alors, en tant que mécanisme de défense contre cette angoisse. Il consiste à protéger le bon objet interne du sadisme, et à préserver une bonne relation avec lui. L’enfant parviendrait, à la suite de ce stade, à reconnaitre l’objet de son unicité, l’admettre dans sa totalité. La frustration envers l’objet, perdra, alors, ses effets destructeurs. Au lieu de le craindre, l’enfant sollicite l’objet et entre, ainsi, dans la position dépressive. À la différence des angoisses paranoïdes, égoïstes de nature, les Page 5 angoisses dépressives sont altruistes. Elles sont nécessaires pour tempérer les angoisses paranoïdes (angoisses de nature dissociative). En effet, la crainte de perdre l’objet aimé établit chez l’enfant trois transformations à l’égard de l’objet: • la crainte de se priver de l’objet aimé se substitue par sa sollicitude; • l’illusion de destruction de l’objet, de l’attaquer, engendre le sentiment de culpabilité et de pitié; • Et, enfin, le souci de la restauration et de l’identification avec l’objet unifié. C’est Le clivage, qui s’applique à des imagos de cet objet unifié, qui est utilisé pour se défendre de l’angoisse de perte de l’objet, vécue comme réelle, et pour inciter, grâce à l’introjection, à la restauration et à l’identification. En conséquence, le clivage favorise une relation d’objet fondée sur la confiance et la paix. Toutefois, la réussite de ce processus progressif dépend de la “qualité du clivage”, son degré de perméabilité, sa réduction au fil des intégrations successives et s’il permet au sujet de reconnaitre l’objet et de “domestiquer” les pulsions sadiques. C’est ainsi que la position dépressive peut être dépassée.
Conclusion
On peut conclure donc, que le clivage d’objet est utile dans son aspect organisateur qui peut mener progressivement, selon Klein, le jeune enfant vers l’intégration du Moi et développer la capacité de synthèse des sentiments infantiles à l’égard de l’objet. Ce progrès s’accompagne d’une capacité croissante de différenciation du monde extérieur, d’une extension des intérêts et d’une aptitude accrue à la communication avec autrui. Ce genre de développement indique que les pulsions de vie prédominent les pulsions destructrices. Pourtant, ça ne va pas de soi. Au-delà de la relation alimentaire avec la mère, relation médiatisée par le sein, la gratification et l’amour dont le bébé a l’expérience, dans cette relation, l’aide à neutraliser l’angoisse de persécution et même les sentiments de perte et de la persécution suscitée par l’expérience de la naissance. En outre, la lutte contre l’angoisse nécessite le recours, permanent, à des défenses “comme le contrôle tout-puissant de l’objet, lié à la toute-puissance de la pensée, qui va de pair avec le déni”. Ainsi, l’enfant affirme, sa toute-puissance dans ses phantasmes de domination absolue sur l’objet qu’il peut de la sorte maîtriser à son Page 6 gré. Le déni, aussi, lui permet de supprimer radicalement la situation de déplaisir et l’objet frustrant qui s’y trouve attaché. L’échec d’une telle stratégie défensive, où se mêle le clivage de Moi et de l’objet, la projection, l’introjection, le déni magique, le contrôle tout-puissant de l’objet, peut conduire à la désintégration du Moi. Celui-ci, par sa fonction, tend à l’intégration de ses divers aspects, à concilier l’amour et la haine et unifier ce qui a été clivé. La nature d’angoisse change à ce stade. De l’angoisse paranoïde à l’angoisse dépressive, étroitement liée au développement du Moi. L’avenue de la position dépressive est marquée par la domination des émotions nouvelles, qui toutes se cristallisent autour de la nostalgie de l’objet d’amour. L’angoisse d’une persécution interne ou externe, sans disparaitre totalement, cède le pas à une inquiétude qui s’attache au destin de l’objet source premier, dès ce moment, des préoccupations infantiles. Conclusions À titre de conclusion, le clivage du Moi est un processus normal qui peut se plancher dans la pathologie. Le clivage du Moi normal est un mécanisme de défense et de structuration qui permet au Moi de bien assumer ses responsabilités de synthèse qui facilitent au sujet une bonne intégration et la liberté d’identification et d’investissement. Par contre, le clivage du Moi pathologique est le produit du débordement pulsionnel contre lequel le Moi recourt à des défenses drastiques. Le clivage pathologique fait coexister deux attitudes opposées: le respect de la réalité et la dénier, en même temps, toute en la remplaçant par une réalité fantasmée. Quant au clivage de l’objet, Melanie Klein sépare le clivage d’objet (et de Moi) structurant et organisateur, du clivage schizoïde (plus pathologique). Le premier concerne le clivage entre un Moi heureux, en relation avec un objet gratifiant, et un Moi violent et destructeur, en relation avec un objet mauvais et frustrant. Il protège le Moi des frustrations et des persécutions internes et externes. Le deuxième est la conséquence du conflit de l’objet persécuteur et l’objet idéalisé, ou envié. Klein considère que l’idéalisation est une défense qui permet à l’enfant de faire face à l’intensité des pulsions destructives, d’envie et d’angoisse de persécution.
Ecrit par Abdeslam Oulbaz (Psychanalyste, Maroc)


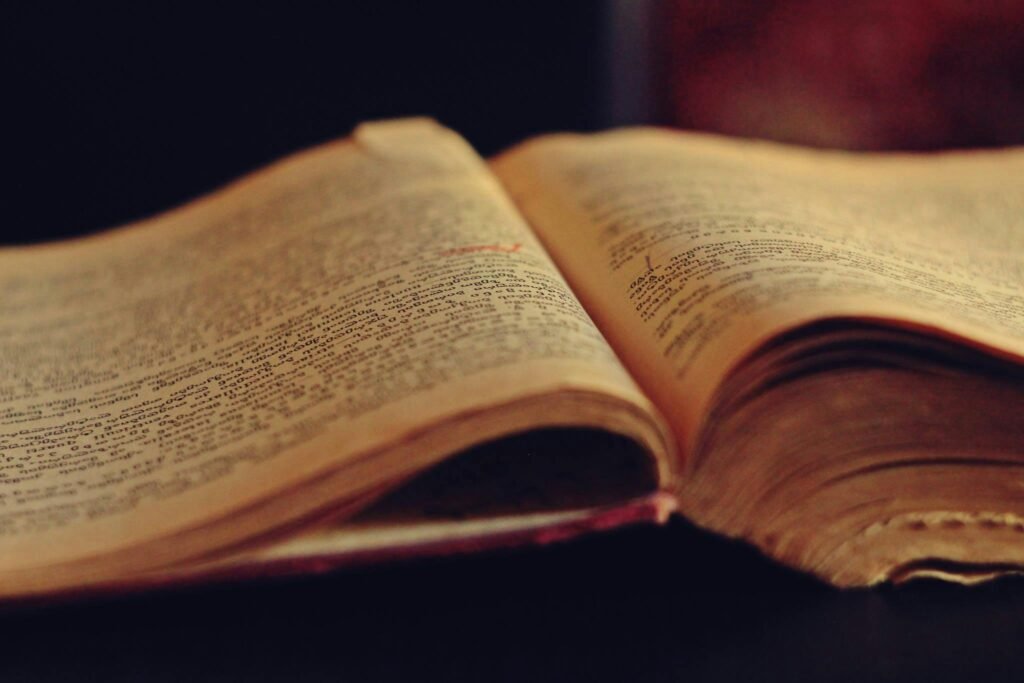
No responses yet