Page1
L’identification est le processus qui permet au ‘je’ de s’approprier une identité, une présence dans le monde définie par des attributs et un statut personnel, une individuation.
Le mot processus désigne une suite continue d’opérations, d’actions et une manière que quelqu’un, un groupe, a de se comporter en vue d’un résultat particulier répondant, psychiquement, à un développement psychologique normal ou pathologique.
Pour Freud, il y a deux types de processus : le processus primaire et le processus secondaire. Le processus primaire est caractéristique, dans la première topique, de l’inconscient, tandis que le processus secondaire correspond aux registres préconscient et inconscient. L’écoulement de l’énergie psychique, au sein des processus primaires est libre alors que cet écoulement est lié et contrôlé, dans le processus secondaire. Le processus primaire est guidé par l’identité de perception qui vise à retrouver une perception identique à l’image de l’objet résultant d’une expérience de satisfaction. Cependant, le processus secondaire est guidé par une identité qui concerne les pensées. Par identité de pensée, le processus secondaire lie l’énergie aux représentations et l’écoule sous le contrôle du principe de réalité, ce qui permet l’émergence d’une pensée logique relativement affranchie de la pression du désir de satisfaction immédiate.
Selon Freud, le processus identificatoire s’exprime en trois modes:
– L’identification primaire répondant à un besoin oedipien, pour le garçon, à un désir d’être le père, pris comme modèle, pour retrouver l’objet manquant : le désir d’avoir la mère. Le complexe d’OEdipe normal dépend de l’articulation de ses deux liens : le garçon s’identifie au père pour prendre sa place au regard de la mère. En considérant le lien entre l’identification et l’incorporation, L’identification primaire serait un précurseur du lien objectal, comme dans le cas de l’OEdipe inversé, où l’objet de l’identification devient par la suite l’objet des pulsions sexuelles.
– L’identification narcissique répond à une régression à partir d’une relation objectale jusqu’à l’introjection de l’objet dans le Moi. La personne aimée est y copiée. La toux de Dora témoigne de cette régression narcissique depuis le lien objectal, elle témoigne à la fois d’une identification narcissique au père, et d’une identification hystérique, identification à la femme du séducteur du Dora, dans un contexte de refoulement des désirs sexuels.
– L’identification hystérique. Elle a lieu à partir de la perception d’une certaine communauté avec une personne qui n’est pas objet des pulsions sexuelles. Les manifestations de la contagion mentale est un exemple des réponses pathologiques de cette identification.
Lacan met en lumière deux types d’identification : l’identification imaginaire et l’identification symbolique.
L’identification imaginaire est « la transformation produite chez l’individu quand il assume une image »i. Elle est le mécanisme par lequel le Moi est créé pendant le stade de miroir. C’est en assimilant son image réfléchit devant le miroir que le « je » se précipite en une forme primordiale, avant que l’identification à 2A1_OULBAZ_ABDESLAM_PATHOLOGIE_190615
Page2
l’autre ne lui accorde une identité objective, et que le langage ne lui restitue sa fonction du sujet dans l’universel. Cette forme est désignée comme une je-idéal qui sera le socle des identifications secondaires. Le « je ’‘apprends en sa constitution par son image « sa discordance d’avec sa propre réalité ». ii
L’identification symbolique, selon Lacan, est l’identification à un signifiant, qui est le père dans le dernier stade du complexe d’OEdipe. Elle est le fondement de l’idéal du Moi en tant que signifié de privilège.
En effet le « je » imaginaire, qui est synonyme du narcissisme primaire, doit être substitué par le « je » symbolique ou l’idéal du Moi. « L’enfant sort de son narcissisme primaire lorsque son Moi est confronté à un idéal auquel il doit se mesurer »(Freud).
Le Surmoi est l’instance psychique responsable de mener le Moi à cette « satisfaction idéale » et de fuir la satisfaction narcissique. Le Moi répond par déplacement de l’expression érotique des pulsions dans les expressions créatrices comme l’art, la musique… et les pulsions hostiles dans l’activité sportive.
Freud estime que l’idéal du Moi est le refuge où les investissements du narcissisme primaires trouvent place. L’idéal du Moi est le substitut du narcissisme primaire. Le fantasme de la perfection établit dans le travail du Moi idéal va être « sublimé » donc. Le développement du Moi consiste à s’éloigner du narcissisme primaire et engendre une aspiration intense à recouvrir ce narcissisme. Recouvrement qui se réalise par déplacement de la libido sur l’idéal du Moi, siège du narcissisme et son héritier.
Cependant, la réussite de l’assimilation de l’idéal du Moi est soumette à une condition : la capacité de l’être à différencier l’idéal reçu du dehors, dans les messages critiques des parents, de l’idéal tel qu’il est transféré.
L’identification projective est le mécanisme mis en oeuvre pour que l’être accepte l’idéal du Moi. Elle est le processus psychique qui explique le pouvoir qu’a un sujet à introduire sa propre personne dans un objet pour le posséder et le contrôler. C’est ainsi expliqué les deux actes de transmission et de transfert (transfert des investissements du narcissisme primaire dans l’idéal du Moi) de l’idéal du Moi. Ces deux actes doivent être différenciées pour que les investissements du narcissisme primaire et d’intériorisation des relations d’objets du monde extérieur, qui construisent l’idéal du Moi, facilitent l’héritage de cet idéal.
On peut conclure donc à cette hypothèse : la normalité du processus identificatoire est le résultat de « l’idéalisation » du narcissisme primaire pour que l’enfant hérite l’idéal narcissique des parents : l’idéal du Moi. Alors que la défaillance pathologique est la conséquence d’une défaillance de l’idéalisation.
Cette défaillance est vérifiable dans l’identification narcissique et l’identification hystérique.
L’identification narcissique
L’investissement libidinal de l’objet, qui est la traduction d’ une identification normale, est nécessaire à l’installation du Surmoi. Dans l’identification narcissique, néanmoins, l’objet n’est pas investi. Il est introjecté dans le Moi. La libido est y alors retirée et sert à une identification du Moi avec l’objet abandonné/manqué. L’investissement libidinal de l’objet manque donc dans le processus de l’identification narcissique. 2A1_OULBAZ_ABDESLAM_PATHOLOGIE_190615
Page3
Ce destin explique, pour Freud, l’homosexualité masculine. Elle est l’expression de l’identification de la mère érotisée qui symbolise le fantasme de l’enfant idéal qu’il a été. On y voit le fonctionnement de l’identification projective consistant à déposer dans le parent co-sujet une partie infantile du soi. C’est l’interprétation que pensait Freud dans le texte Léonard de Vinci.
L’identification narcissique est mise en oeuvre dans les deux destins pulsionnels : le retournement sur le Moi et le renversement de l’activité en passivité. La quête de la jouissance, pour le sujet narcissique, est accomplie en échangeant sa place avec un autre : le masochiste échange sa place avec le sujet sadique et ce dernier avec le sujet souffrant alors que l’exhibitionniste jouit par identification au voyeuriste. Le travail de l’identification projective est prouvé dans ces mouvements.
Le cas de l’homme aux loups exprime, pour Freud, le renversement du sadisme, provenant d’une régression libidinale jusqu’au stade anale, dans le masochisme sous l’effet de la culpabilité.
En effet, le développement sexuel de l’homme aux loups a été perturbé par suite d’évènements de portée sexuelle : le jeune homme était attaqué par des menaces de castration devant son onanisme, séduit traumatiquement par sa soeur et a été témoin d’une scène primitive à l’âge d’un an et demi. Il a développé, en conséquence, une organisation homosexuelle refoulée et aménagée sur le mode obsessionnel. Cette analyse a été tirée de l’interprétation du rêve où l’enfant aux loups fit quelques jours avant le noël qui marquait son quatrième anniversaire. L’enfant rêve qu’il est dans son lit, soudain la fenêtre s’ouvre et il voit sur les branches d’un grand noyer face à la fenêtre 6 ou 7 loups blancs avec de grandes queues de renard. Terrifié à l’idée d’être mangé par les loups, l’enfant crie et s’éveille.
L’identification chez l’homme aux loups à la mère s’effectue sur le mode hystérique alors que l’identification au père se réalise sur le mode narcissique. En effet, l’homme aux loups a le désir d’occuper la place de la mère auprès du père, place enviée, dans une attitude homosexuelle passive voire masochiste. Différemment, l’identification au père exprime un choix libidinal du père comme objet narcissique.
L’identification hystérique
L’identification hystérique est un concept élaboré par Freud dans le contexte de son interprétation des symptômes hystériques. L’identification a lieu à partir de la perception d’une certaine communauté avec une personne qui n’est pas objet des pulsions sexuelles. Ses expressions pathologiques sont, par exemple, les manifestations de contagion mentale.
Le cas de Dora, cité de Cinq Psychanalyses, est significatif. Dora, jeune fille de dix-huit ans que son père l’oblige à consulter un psychanalyste pour guérir de ses sauts de caractère, de ses fantasmes sexuels et de ses lectures pornographiques et d’un certain nombre de trouble somatiques (aphonie, toux…). L’articulation du psychique et du somatique, dans le cas de Dora, est le signe de la conversion hystérique. Cette conversion du psychique en somatique à été proposé par Freud en 1894 dans les psychonévroses de défense. Freud a pu renforcer l’idée que la conversion hystérique en séparant la représentation de l’affect, convertit celui-ci en un symptôme tandis que la représentation est refoulée. 2A1_OULBAZ_ABDESLAM_PATHOLOGIE_190615
Page4
Lacan, dans son élaboration de la structure de l’hystérie, insiste sur la question de l’articulation du désir à l’identification. C’est ainsi qu’on peut dire que la petite hystérie de Dora se réduit à une identification aux personnes qui ont influencé, traumatiquement, sa vie : le père, la servante et son mari, la mère et son frère. Lacan interprète le souvenir que Dora a raconté à Freud, (Dora suçote son doigt en tirant sur l’oreille de son frère de 18 mois son puîné), comme une identification spéculaire qui s’est constitué sur ce petit autre qui est le petit frère. Dès lors cette image masculine lui servira de moi-idéal. Le Moi que Lacan traduit comme moi du moi en tant qu’image aliénante. iii
Pour Lacan, le ballet à quatre (Dora, le père, MR.K, Mme K) permet de poser une troisième forme d’identification. Non pas une identification au père à travers le symptôme hystérique, mais à un petit autre, petit semblable, à travers le lien imaginaire spéculaire, c’est celle qui spécifie le lien de Dora à Mr.k. Un lien qui s’est fait tenir jusqu’au moment de la décompensation névrotique.
L’interprétation du rêve « rêve de saumon fumé »iv ou « rêve de la bouchère » éclaire de mieux le processus de l’identification hystérique . La patiente de Freud réalise le rêve suivant :
« Je veux donner un souper, mais je n’ai rien d’autre en réserve qu’un peu de saumon fumé. Je pense aller faire des achats, mais je ne me souviens que c’est dimanche après-midi, moment où tous les magasins sont fermés, je veux alors téléphoner à quelques fournisseurs, mais le téléphone est en dérangement. Il me faut donc renoncer au souhait de donner un souper ».
Ce rêve avait été devancé par des antécédents : La volonté du mari de la bouchère de commencer une cure d’amaigrissement, suivre un régime strict, faire de l’exercice et ne plus accepter l’invitation à manger.
Elle-même souhaitait pouvoir manger un petit pain au caviar, mais ne se permettait pas la dépense. Après avoir surmonté quelques résistances, elle relate sa jalousie pour une femme que son mari apprécie. Celle-ci est très maigre, alors que son mari est désireux des femmes en chair. Naturellement rendre visite à cette femme, celle-ci lui évoqua son souhait de devenir plus forte et de venir manger chez eux où l’on mange bien.
Le sens de rêve était clair pour Freud : sa patiente pense que son amie veut être invitée pour bien manger, grossir et plaire à son mari. Quant au saumon fumé, c’est le mets préféré de son amie. Son souhait sera donc que son amie ne prenne pas d’embonpoint. Or, dans le rêve, c’est pour elle qu’un souhait n’est pas accompli, celui de manger de saumon et d’inviter à manger.
S. Freud nous dit : « elle s’est identifiée à elle. » « L’identification, écrit-il, est un facteur extrêmement important pour le mécanisme des symptômes hystériques ; par cette voie, les malades parviennent à exprimer dans leurs symptômes les expériences vécues d’une grande série de personne et pas seulement celle qui leur sont propres, à souffrir en quelque sorte pour toute une multitude humaine et à jouer tous les rôles d’un spectacle »v
Il explique que l’identification hystérique n’est pas simplement imitation, « mais elle est appropriation sur la base de la même revendication ». Et, plus loin : « elle exprime un « de même que » et se rapporte à un élément commun qui repose dans l’inconscient. » 2A1_OULBAZ_ABDESLAM_PATHOLOGIE_190615
Page5
Et Freud de conclure : « l’identification est le plus souvent utilisée dans l’hystérie pour exprimer une communauté sexuelle. » l’hystérique s’identifie principalement aux personnes avec lesquelles elle a eu un commerce sexuel dans le réel ou non ou bien qui ont un commerce sexuel avec les mêmes personnes qu’elle.
La patiente «se met donc à la place de l’amie dans le rêve, parce qu’elle voudrait occuper la place de celle-ci dans l’estime de son mari ».
Identification et psychose
La mélancolie
Le mélancolique est affecté d’une profonde souffrance morale, d’une anxiété permanente, d’un sentiment de culpabilité et d’une diminution de l’activité psychique et psychomotrice. La cause de la mélancolie réside principalement dans l’impossibilité permanente de faire le deuil de l’objet perdu. Ce qui se manifeste par une exagération des besoins d’affection et d’estime qui se transforme en agressivité traduit par une culpabilité envahissante. Ces prédispositions trouveraient leur origine dans une fixation au stade sadique-oral, période où le rapport à l’objet se fait par l’incorporation de celui-ci.
Le problème dans la mélancolie réside dans l’impossibilité de mettre en place le symbolique qui permet à la négation du primaire de s’exprimer en mode constructivité/pulsion de vie. Chez le mélancolique la négation se formule d’une manière originaire, c’est-à-dire au coté de la destructivité qui appartient à la pulsion de mort. L’identification du mélancolique s’énonce dans l’expression « je ne suis rien ». M-CI-Lambotte dit que « le mélancolique s’est identifié à rien. Il s’exclurait donc en tant que destinataire d’une intention, en tant qu’allocutaire d’un message, ou bien encore en tant que sujet de jouissance. »vi
Cette identification à rien donne lieu à une pseudo-identité, une prothèse de nom. Le mélancolique élabore une image sous les traits d’un modèle idéal tout puissant qui est l’origine de la dévitalisation de son univers. Il n’est pas assez subjectivé parce qu’il aurait une image désaffectivée de lui-même. C’est pourquoi le mélancolique n’arrive pas à faire le deuil, car le deuil, nous dit Lacan : « consiste à authentifier la perte réelle, pièce à pièce, signe à signe, jusqu’à épuisement. Quand cela est fait, le deuil est fini ». « Dans le deuil, dit Freud, le monde est devenu pauvre et vide. Dans la mélancolie, c’est le moi lui-même. Si dans le deuil normal, la perte semble se situer au niveau d’un objet extérieur, dans la mélancolie, c’est au niveau du moi que la perte se situe » . La libido se retire sur le moi provoquant une hémorragie traduite dans les auto-reproches et dans l’identification à un rien plein qui constitue sa seule identité : je ne suis rien.
Conclusion
On peut ainsi conclure que toutes les formes pathologiques dues à l’identification sont engendrées par la modalité que prend la relation du « je » à l’objet. Deux modalités sont éclairées dans la littérature psychanalytique : la modalité hystérique, manière de réaliser la possession de l’objet par appropriation. Une appropriation exprimée dans les manifestions psychiques reflétant les états intérieurs de plusieurs personnes ainsi que la symptomatologie d’autres personnes : les cas des patients hystériques se retrouvant 2A1_OULBAZ_ABDESLAM_PATHOLOGIE_190615
Page6
paralysée en voyant une personne paralytique. Et la modalité narcissique qui relève aussi du désir de la possession de l’objet, mais la pathologie tient du fait que l’objet est introjecté dans le Moi a tel point d’anéantir le sujet, obligé à s’identifier au rien.
L’identification « pathologique » explique des pathologies comme l’autisme. Esther Bick, dans les années 70, parle de l’identification adhésive (elle recommande de parler de l’identité adhésive à la fin de sa vie). « Essentiellement, adhésivité signifie qu’on n’a pas encore atteint l’étape d’être capable… d’être un être humain pour ainsi dire : vous devez être la sangsue, vous devez être le genre animal qui ne peut pas être par lui-même, vous devez coller… »vii. Cette identification empêche la satisfaction symbolique (par la pensée), car le souvenir de l’objet satisfaisant est remplacé par le contact réel et permanent avec cet objet.
La paranoïa montre la tournure inverse de l’identification du fait que le sujet identifie cette fois ci ses propres aspects aux autres. En impliquant une latente homosexualité ou une lutte inconsciente contre les désirs homosexuels (point de vue controversé). L’identification à la mère, qui explique l’homoérotisme et ses variations, joue un rôle important dans l’étiologie de la paranoïa. Elle s’agit d’une psychose chronique sans évolution déficitaire, caractérisée par un délire systématisé, hallucinatoire ou interprétatif. Des délires très argumentés, très solides, très convaincants mais avec une base de raisonnement fausse qu’il est inutile de mettre en doute La personnalité paranoïaque se défend contre les pulsions homosexuelles en les projetant sur autrui. Elle constitue une régression au stade sadique anale caractérisée par une attitude agressive, destructrice, envers les objets, notamment les images parentales et, par voie de conséquence, la crainte inconsciente d’être angoissé par eux. Le jeu de l’identification projective est bien clair dans la paranoïa tout en considérant l’interprétation de Hinshelwood :
Il est un fantasme inconscient qui produit une croyance dans certains aspects de soi-même cherchés chez autrui, avec comme conséquence un épuisement et une fragile identité et de Moi, et qui va jusqu’à la dépersonnalisation ; sentiments profonds d’être perdu ou un sens d’emprisonnement.viii
C’est Bionix qui a développé les concepts de l’identification projective normale et anormale. Il a postulé que la différence se situe au niveau du degré de la violence ou la force impliquée dans le processus de la projection. Bion affirme qu’il deux options dans l’identification projective :
1- La violente expulsion de la souffrance qui implique la pénétration forcée dans l’objet, au sein du phantasme, avec le voeu de contrôler et intimider l’objet ;
2- La communication avec l’objet pour y faire entrer un état d’esprit.
L’identification projective est employée souvent avec une force considérable pour défendre contre une peur de séparation profonde et de l’isolation. Elle est démontrable chez les sujets cherchant fusion avec leurs objets. L’utilisation intrapsychique excessive de l’identification projective peut indiquer aussi l’internalisation d’un objet idéalisé, qui échappe à l’assimilation, que le patient libère le temps de stress émotionnel et de crise. Ce genre d’identification est noter dans les addictions, les troubles de nutrition, les para-suicides et dans les roubles bipolaires. 2A1_OULBAZ_ABDESLAM_PATHOLOGIE_190615
Page7
i [Ecrits, 94]
ii [Ecrits, 94]
iii Lacan.5
iv [Freud, L’interprétation des rêves, 1900, PUF1967, p 133-35]
vi http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/28-BF27CALBERG.pdf?phpMyAdmin=0k39wA0M-rYtTueZFUi-nHQMKb1
vii[Brochure M. Haag, pp. 90-91]
viii Bion, W.R. (1959). Attacks on linking. International journal of Psycho-Analysis, 40: 308-315. In Paranoïa and Psychotic Process : Some Clinical Applications of Projective Identification in Psychoanalytic Psychotherapy ALISTAIR D. SWEET, MA (PsyA), MSSc Dip. Couns (PsyD), MBACP
ix Rosenfeld, H. (1947). Analysis of a Schizophrenic State with depersonalization. International Journal of Psycho-Analysis, 28: 130-9. In Paranoïa and Psychotic Process : Some Clinical Applications of Projective Identification in Psychoanalytic Psychotherapy ALISTAIR D. SWEET, MA (PsyA), MSSc Dip. Couns (PsyD), MBACP
Herbert Rosenfeld(1988) dans son travail avec les patients psychotiques, a exploré les variantes manifestations de l’identification projective et souligné les différences entre le mode communicatif et le mode destructif du mécanisme. Le premier est décrit comme :
« Une distorsion ou intensification de la relation infantile normale, qui est basée sur la communication non-verbale entre la mère et l’enfant, dans laquelle s’influe des parties du Moi et des anxiétés, que l’enfant est incapable de supporter, et qui sont projetés dans la mère. Celle-ci est, instinctivement, capable de répondre en contenant et en atténuant l’anxiété de son enfant par son comportement »(1988, p.121)
Le mode destructif est vu, par Rosenfeld et Bion, comme un processus impliquant le vidage hors de l’esprit et, in extremis, la dénudation de la capacité de mentalisation ( de symbolisation). Ce processus est décrit comme une tentation de débarrasser l’esprit des aspects divisés du Moi, les objets et les anxiétés reliées à ses aspects.

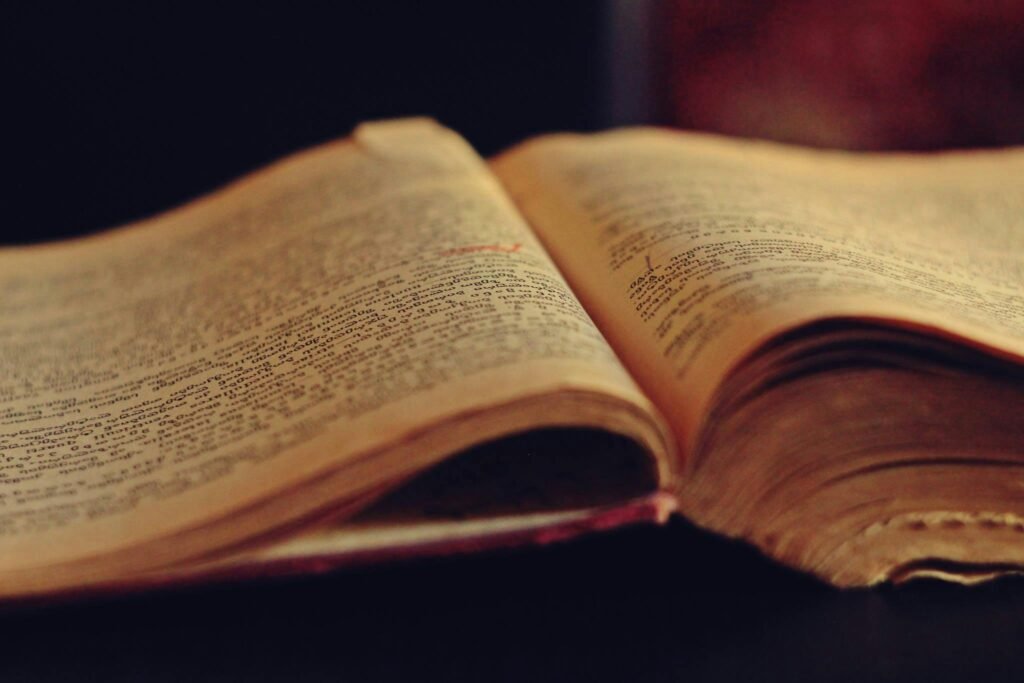
No responses yet