1A1_OULBAZ_ABDESLAM_IDEAL_17215
Introduction
Je suis dans le monde avec Autrui. Un être, un Moi présent. Mais, comment définis-je mon Moi ? Tu es ce Moi conscient qui contrôle ses comportements, connait ses pulsions, libre dans ses pensées, créatif…, m’assure la plupart des philosophes. Tu es, en revanche, un sujet régi par l’inconscient, produit de son historique infantile. Je suis le résultat de mon développement psychosexuel sur lequel je n’avais plus de pouvoir, m’avoue les psychanalystes.
« Au commencement, il y a le ça, disait Freud ». Une formule de Genèse. Je n’étais qu’un être désirant qui cherche le plaisir et évite le déplaisir. Cela est manifesté, déjà, par l’auto-érotisation intra-utérine. Le sein de maman était mon objet de plaisir. Je l’incorpore et me procure une force fantasmatique. C’est le Moi Idéal. Ce fantasme de Moi issu du Narcissisme et correspond à une étape de son évolution. Il est préoedipien. Le Moi Idéal est une formation narcissique inconscient conditionné par l’identification à une personne idéalisée. Je l’ai vécu comme un état de perfection. Il survient, selon Lacan, au stade de miroir. Le stade pendant lequel le Moi intègre l’image d’un corps unifié qui engendre le sentiment d’unité personnelle, mais cette image reste idéale inatteignable par le Moi car elle est vécue comme un idéal désiré, accompagné par un investissement libidinal. Le Moi Idéal est donc « une formation très archaïque » à laquelle correspond un Idéal trop puissant du Narcissisme primaire. Il comporte d’après Lagache « une part d’identification à l’être le plus fort, à la mère ».
Maman que j’aime ! Maman qui m’a assuré la survie. Mon attachement à elle n’est pas dû seulement à ce besoin biologique, mais, aussi, parce que ma mère est un objet de plaisir sexuel par lequel je me débarrasse de mes pulsions destructrices et de mon angoisse de persécution, selon les interprétations de Mélanie Klein. C’est le secret de l’étayage. Ce terme qui désigne chez Freud la relation étroite entre les pulsions sexuelles et les pulsions d’autoconservation : les pulsions sexuelles font des pulsions d’autoconservation le moyen pour se décharger organiquement. La relation libidinale avec la mère, origine du Moi Idéal, va changer par l’intervention d’un tiers qui partageait maman avec moi. C’est mon père ! Je le déteste. C’était logique non ! Il est la cause de ma première blessure narcissique. Mais c’est mon papa. Une voix sociale m’interdit de le détester et je suis obligé de manifester des sentiments tendres envers lui. Pire que ça, mon désir pour ma mère est incestueux, il est inacceptable. Cette même voix soulevait contre moi : « cesse de désirer ta maman, elle n’est pas à toi, elle est à ton papa ». Le conflit oedipien s’amorce alors. L’installation du Surmoi, « l’héritier de l’oedipe », mettra fin à ce conflit. Le Surmoi assume trois fonctions :
– Une fonction d’auto-observation ;
– Une fonction de la conscience morale ;
– Une fonction idéale, à qui s’applique l’idéal du Moi.
Le Moi comme instance de l’appareil psychique joue le rôle de médiateur entre les voeux de Ça et les interdits surmoïques. Des voeux que la réalité et la société traitent et donnent l’ordre au Moi de les refouler s’ils ne sont pas possibles ou acceptables, et de les laisser passer dans le cas contraire. Le Moi procède, inconsciemment, donc par des mécanismes de défense pour mener l’adaptation du sujet avec la réalité et la société. Si le Moi échoue, la souffrance s’installe ainsi que la névrose. Le Surmoi et l’idéal du Moi sont deux instances qui aide l’enfant à substituer son narcissisme primaire. Trois mécanismes de défense interviennent alors : le refoulement, la sublimation, et l’idéalisation.
Le refoulement, décrit par Freud dès 1895, est un mécanisme de défense qui intervient vers 6/7 ans. Il est « un processus actif » destiné à chasser du champ de la conscience les représentations inacceptables des pulsions interdites. Il est le mécanisme principal des Névroses lorsqu’il est massif. Ce mécanisme n’est jamais complétement réussi. Les pulsions refoulées trouvent toujours des issues pour s’exprimer : Lapsus, actes manqués, rêves…malgré que le refoulement pompe beaucoup d’énergie. L’incomplétude du refoulement laisse infiltrer les représentations et les pulsions défendues entrainant, par conséquent, des déviations dans le développement normal du sujet et remémorise l’angoisse dépassé. L’application de soi serait manqué à cause du refoulement.
La sublimation, si le refoulement affaiblit la libido, la sublimation la renforce au contraire. La sublimation est le mécanisme de défense réussi. Elle est concernée par le but de la pulsion et travaille pour remplacer le but interdit par un nouveau but que le Surmoi autorise. L’adaptation à la réalité ainsi que la sociabilité sont réalisées grâce à ce mécanisme puisque l’individu se met au service de la société et de la civilisation. La sublimation met fin au complexe d’oedipe : le sentiment du désir et de crainte des parents est substitué, par les sentiments de tendresse.
L’idéalisation : L’idée du parfait a dominé les esprits depuis l’antiquité, mais le parfait est inhumain. Le processus d’idéalisation explique cette conquête, propre à l’homme, du parfait. L’enfant idéalise ses parents au premier plan. Une opération nécessaire pour :
– Maintenir ses liens d’amour et de protection avec les parents ;
– Et pour que l’identification joue son rôle dans la construction narcissique de l’enfant.
On peut dire que ses trois mécanismes de défense : le refoulement, la sublimation et l’idéalisation structurent, dynamiquement, le Moi. Le refoulement donne au Moi une dimension réelle et social qui se fait en conflit entre le désir, circonstances de la réalité et les conditions sociales. La sublimation l’oriente vers des objectifs nécessaires pour la phylogenèse. Enfin, l’idéalisation est nécessaire pour chercher des idéaux en conformité avec son époque, son intelligence et son esprit créatif. La névrose peut s’expliquer donc par l’échec du Moi à intégrer normalement la société, la réalité et à répondre aux exigences de l’idéal du Moi. Cet échec serait senti comme blessures narcissiques d’où les troubles d’adaptation caractérisant les personnes névrotiques.
Le Moi se constitue principalement par deux processus identificatoires et du Narcissisme : 1) Une identification primaire prégénitale « liée à l’incorporation orale. L’objet doit être dévoré sans distinction préalable entre tendresse et hostilité ; ni entre le moi et le non-moi ». Elle forme l’identité basique du sujet ;
2) Une identification secondaire qui affirme l’identité sexuelle de l’enfant. Le sujet absorbe les qualités de son objet aimé au complexe d’oedipe tout en renonçant au désir de l’incorporer. Le Narcissisme est un état psychique du Moi. Il l’investit alors que son pendant, l’investissement libidinal objectal, est dirigé vers la pulsion. Si la normalité s’établit grâce à un équilibre entre ses deux investissements, la pathologie, par contre, est la conséquence de leur déséquilibre.
Le développement psychosexuel, pour Freud, se réalise au cours des stades évolutifs durant lesquels le Moi se construit progressivement du point de vue topique, économique et dynamique. Or, Les régressions, les fixations et les ratures (au sens lacanien) entachent le développement normal du Moi. La fixation est l’attardement de la libido à l’un des stades du développement. Il est causé par des évènements malsains de la vie : traumatismes, blessures, attitudes parentales inadéquates… La régression est liée à la fixation parce que la libido va se fixer en retournant à un stade dépassé. La Névrose serait la conséquence de certaines fixations. L’appareil psychique se construit, donc, au cours de ce développement psychosexuel. Le Ça s’installe le premier grâce à l’autoérotisation intra-utérine qui est l’origine du Narcissisme primaire qui se développe pendant le stade de la capitalisation du Narcissisme, le stade oral. Cette capitalisation fantasmée par le Moi idéal, indispensable pour la normalité, est touché au stade de miroir. L’enfant y constate sa différence d’avec sa mère et réalise qu’il est faible et petit par rapport aux personnes de son entourage. L’entrée au stade anal marque la volonté inconsciente de l’enfant à surmonter cette première blessure Narcissique. Il y prouve sa puissance et s’impose en déchargeant, dit Mélanie Klein, les pulsions de destruction. L’enfant sort, donc, du Narcissisme primaire lorsque le Moi est confronté à un idéal auquel il doit se mesurer, même-si le lien avec la mère reste aussi fort, comme proposait Freud. La deuxième blessure Narcissique est amorcée à l’entrée de l’oedipe, qui annonce la fin du stade anal. L’enfant doit intégrer la réalité que sa mère n’est pas à lui seul. Elle la partage avec un rival qui n’est que son père. Il est obligé à adopter la loi du père. L’entrée à La période de latence, période de la grande enfance, permet à l’enfant de récupérer grâce à l’apaisement des pulsions. Cette période aurait des influences importantes sur le développement personnel. L’enfant y peut :
– Développer son intelligence et se confirmer comme adulte ;
– Réaménager des conflits, processus défensifs et des relations d’objet : le désir ou l’hostilité des parents sont déplacés en sentiments de tendresse et d’amour ;
– Régir ses pulsions par le principe de la réalité et non du plaisir. La pulsion sexuelle devient source de déplaisir car culpabilisante. Elle est dirigée vers des buts non sexuels. La sublimation joue ainsi son rôle qui se traduit en « dégout contre son désir incestueux. La pudeur, la morale, et la propreté contre ses pulsions anales. »
On voit que la période de latence est une période où l’enfant s’exige à parvenir à ses idéaux et ceux de ses parents. La névrose s’installe si l’enfant échoue à les atteindre. Elle s’explique par les sentiments d’infériorité et de culpabilité. La culpabilité relative à la masturbation cache des conflits car les enfants névrosés ne supportent pas la masturbation par crainte des détumescences qui est ressentie comme une castration. Ils cessent de se masturber par conséquent. Ce qui demande un fort investissement énergétique puisque l’inhibition de ce désir touche des domaines non sexuels comme le domaine scolaire. En effet, L’incapacité à intégrer les matières scolaires qui demandent une représentation de l’espace est dû au refoulement qui interdit certains gestes obscènes et leurs représentations mentales. L’enfant a besoin donc d’être encouragé pour développer son autonomie personnelle à son rythme. Les parents qui obligent l’enfant à se conformer à leur désir, créeront un comportement compensatoire qui étayerait le sentiment infériorité chez lui dans le cas où il se sent incapable de répondre aux obligations parentales.
La période de latence pourrait être lieu à des formes névrotiques comme : la névrose obsessionnelle, la phobie et l’hystérie.
Il devient clair que le chemin vers la névrose ou les troubles d’adaptation se construit à travers le parcours du développement du Moi. Le névrosé est un Moi mal évolué. C’est un Moi qui a échoué à parvenir aux exigences de l’idéal du Moi et qui n’a pas capitalisé une force narcissique en se séparant du fantasme du Moi idéal. L’environnement social, éducatifs et les événements de la vie en sont coupables. Les blessures narcissiques sont nécessaires pour l’institution d’un Moi fort. Elles seront détractrices si le sujet échoue à s’identifier à la personne idéalisée pendant le stade oral et à surmonter la première blessure narcissique pour intégrer le stade anal en vue de se prouver et de sublimer son désir incestueux. L’installation du Surmoi avec sa fonction idéalisatrice instaure chez le sujet des exigences qu’il doit chercher continuellement. L’insuccès est synonyme de névrose et de problèmes d’adaptation. Le sentiment d’infériorité et de culpabilité traduisent cet échec à être à la hauteur de soi-même et des idéaux de son époque. Le conflit intrapsychique entre les instances de l’appareil psychique est un conflit couteux économiquement. Il rend, ainsi, le sujet incapable de le surmonter par lui-même. Il serait, donc, dans l’obligation de consulter un psychothérapeute !
Comment cette équation structure les structures névrotiques ?
Le mot structure comprend l’idée de stabilité et d’organisation. En effet, chaque structure psychique est distinguée par des repères structuraux qui détermine son organisation, fonctionnement et traitement.
En psychopathologie, on peut distinguer, grosso-modo, deux structures pathologiques. La structure Névrotique et la structure psychotique. Les deux structures se caractérisent par l’angoisse immotivée qu’elles provoquent. Une angoisse résultante, d’après la psychanalyse, du conflit intrapsychique souvent inconscient.
La notion de névrose* est apparue tardivement au sein de la catégorisation des maladies psychiques. Le conflit qui explique l’angoisse névrotique est de nature sexuelle. Elle est originaire du traumatisme sexuel de l’enfance : « traumatisme qui se passe au niveau du fantasme, même-si tout se passe comme si le traumatisme ayant réellement eu lieu ». (Freud)
L’étude de la phobie de Emma qui craint de se trouver seule aux magasins. Petite, elle a subi les manipulations d’un vieux dans un magasin sans que cela suscite chez elle aucun problème. A son adolescence, les rires de deux jeunes stimulent chez elle des expressions de phobie. La réactualisation de la scène infantile est traumatisante.
Le caractère de la sexualité névrotique est génital : relatif à une position relationnelle dans le conflit oedipien.
Chez le garçon, le conflit découle de la rivalité avec le père dans son objectif de reconquérir la mère. L’objectif remplacé par les sentiments tendres vis-à-vis du père et de la crainte de rétorsion/ angoisse de castration.
Le garçon intériorise l’interdiction du père et le Surmoi, « l’héritier du complexe d’oedipe » s’installe. Par identification, il déplace son désir incestueux vers la possession de la femme.
La fille, cependant, prend une position différente, dans le conflit oedipien, en raison du changement d’objet et de la castration anatomique.
L’hystérie
L’hystérie est une structure névrotique authentique. On peut distinguer deux formes d’hystérie. Hystérie de conversion et Hystérie d’angoisse.
L’hystérie de conversion :
Freud intègre l’hystérie dans le cadre des avatars de l’évolution libidinal. L’ensemble de l’attitude hystérique « correspond à un double mouvement séduction-retrait marquant cette véritable ambivalence au niveau du corps qui est le signe distinctif de l’hystérie ». la névrose obsessionnelle, en revanche, est caractérisée, elle, par une attitude d’ambivalence au niveau de la pensée.
L’hystérique mène une double vie :
– La vie des symptômes, physiques ou psychiques, qui lui donne, semble-t-il une aisance, une insouciance enviable, d’où la belle indifférence de l’hystérique. « La conversion a subtilisé l’angoisse » ;
– La vie d’angoisse réveillée par le sentiment d’abandon, d’impuissance et d’échec dont souffre l’hystérique. Angoisse labile prête à disparaitre à nouveau.
Freud, en 1908, affirme qu’un « symptôme hystérique est l’expression d’une part d’un fantasme sexuel inconscient masculin, d’autre part d’un fantasme sexuel inconscient féminin ».(s. Freud/ les fantasmes) les identifications hystériques, très complexe, peuvent se faire soit à l’objet haï, objet rival du conflit oedipien, « c’est le mécanisme complet de la formation du symptôme hystérique » ² (Freud, psychologie des foules et analyse de moi »), soit à l’objet aimé , mais l’identification prend alors la place du choix d’objet.
Cette explication Freudienne de l’ambivalence hystérique, nous fait comprendre une confusion dû à l’échec du Moi à dépasser l’identification primaire à la mère, objet de Moi Idéal, et à résoudre le conflit oedipien. Le conflit qui installe le Surmoi et l’Idéal du Moi dans le psychisme et contribue à l’adaptation normale de l’individu.
A titre de conclusion, le Moi Idéal et l’idéal du Moi sont indispensable pour la consolidation du Moi. Le Moi idéal est sacrifié pour une adaptation saine avec la réalité et pour que l’Idéal du Moi se met en place pour régler la conduite du Moi par rapport à des objectifs à atteindre, conformes aux idéaux de la personne, tout en respectant le principe de la réalité, c’est-à-dire de ne pas être vécu comme un manque à combler à tout prix.
Références :
Cours de psychothérapie,
Abrégé de la psychologie pathologique. Ed. Masson. 2éme éd. 1976

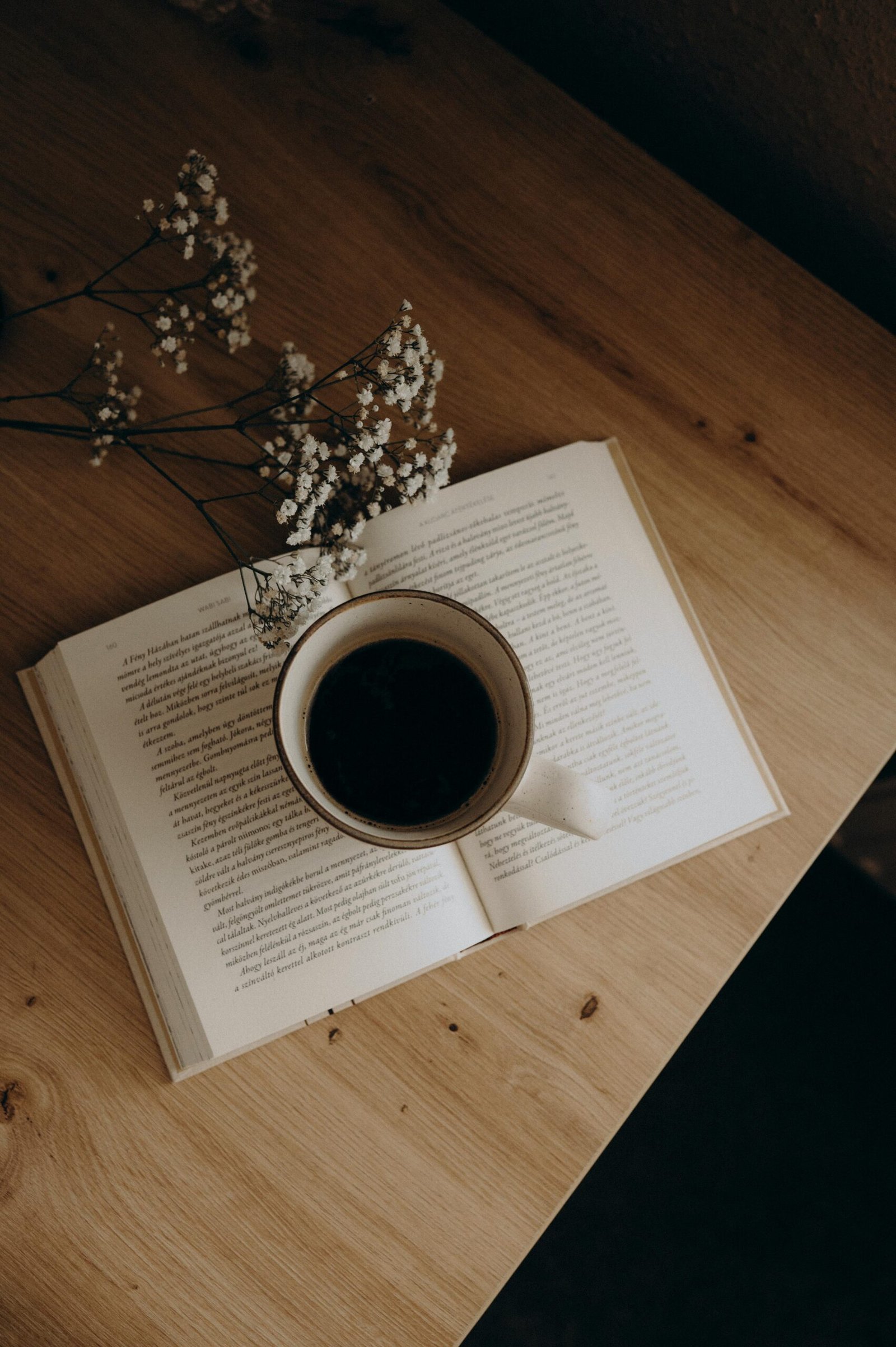
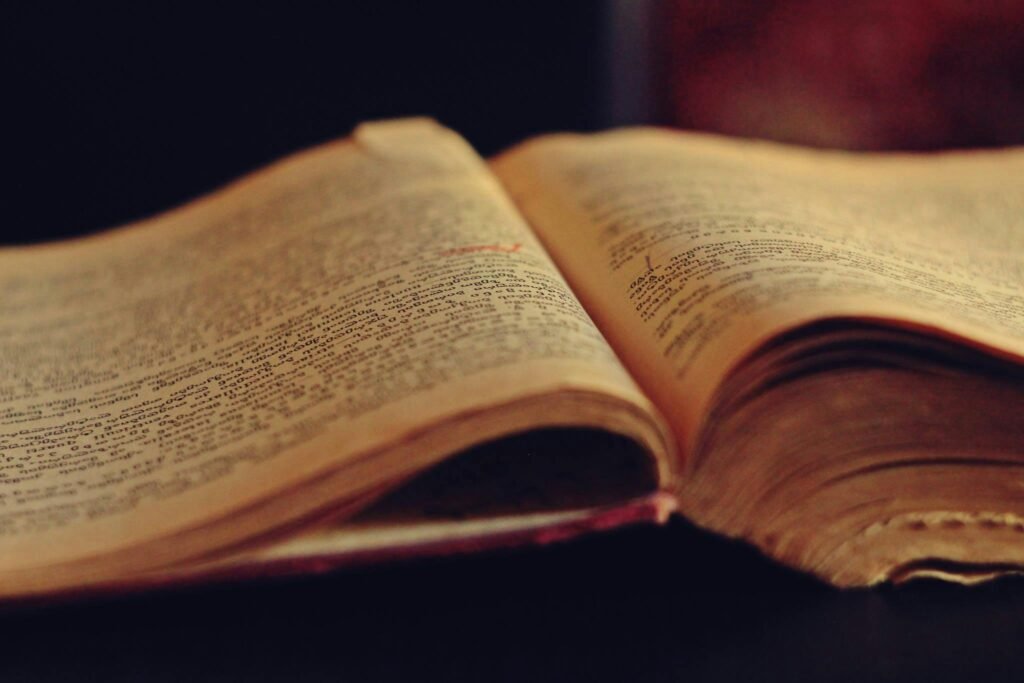
No responses yet